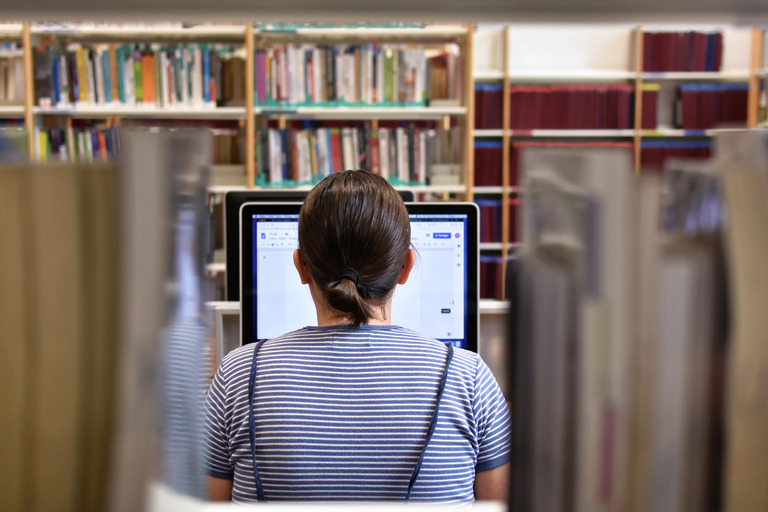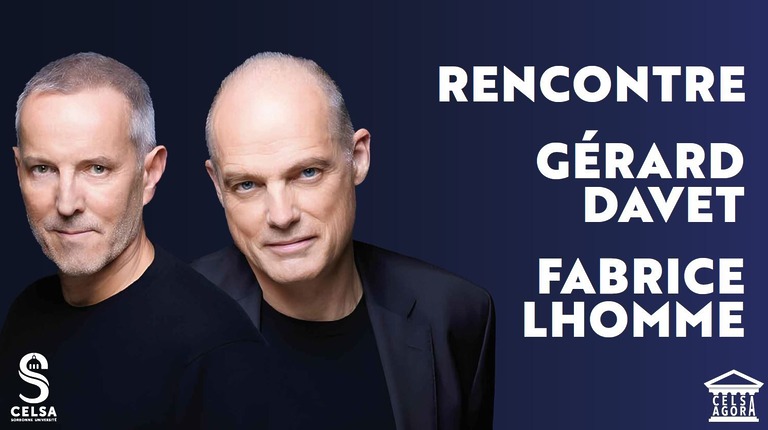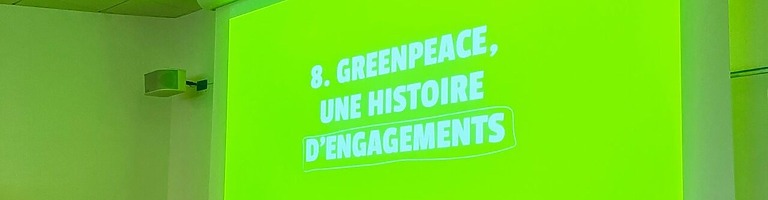Par Emmanuelle Fantin, Maîtresse de conférences- CELSA Sorbonne-Université et chercheuse au Gripic et Sophie Corbillé Professeure des universités HDR – CELSA, Faculté des Lettres, Sorbonne Université et Directrice-adjointe du GRIPIC.
Chaque mois, un enseignant-chercheur ou un professeur associé du CELSA s’empare d’un sujet d’actualité, d’une tendance de société, d’une thématique faisant débat et livre son point de vue. Ce mois-ci, ce sont deux enseignantes-chercheuses qui vous proposent de découvrir une thématique autour de l’actualité climatique : la disparition de la neige.


Parmi l’avalanche de transformations liées aux changements climatiques, la disparition de la
neige est sans nul doute d’une des plus saisissante. C’est notamment le cas en Europe où
année après année, on se désole de sa raréfaction et on s’inquiète du devenir des territoires qui
en vivent. Neigera-t-il à Noël ? Y aura-t-il suffisamment de neige pour faire du ski ? Mais
aussi : est-il encore raisonnable de pratiquer ce sport qui se trouve à la croisée d’usages
parfois conflictuels, comme l’utilisation d’eau pour fabriquer la « neige articifielle » ?
On le voit, la neige n’est pas juste une donnée météorologique ; elle est également un élément culturel constitutif de nos identités, de nos pratiques, et de notre histoire en partage. La disparition annoncée de cette texture si particulière bouleverse tout autant notre futur que nos souvenirs : perdre la neige, c’est alors perdre un peu de notre culture[1].
En quoi la neige façonne-t-elle notre culture ?
Alain Corbin, pionnier de l’histoire des sensibilités, a montré dans ses travaux que le paysage et le climat sont sujets à des appréciations esthétiques, culturelles, chargées d’émotions et historiquement situés[2] . Aussi la disparition de la neige induit elle une transformation de nos manières collectives d’habiter et de traverser les territoires, au point que certaines personnes disent aujourd’hui ne plus reconnaitre le lieu de leur enfance, tant le manteau neigeux a fondu.
Le paysage enneigé est une forme environnementale qui a été, pendant des siècles, structurantes pour les sociétés européennes. D’abord en tant qu’esthétique environnementale, portée par l’histoire de l’art notamment, qui en a fait un topos paysager. Le « petit âge glaciaire », période de refroidissement du climat entre les XIV e et XIX e siècles, a été abondamment représenté par la peinture européenne qui lui a offert un « type » pictural et d’innombrables chef-d’œuvres. Des tableaux de Bruegel à ceux de Monet, les représentations artistiques ont cherché à restituer son intensité, son silence, ses couleurs ou cette mélancolie si spécifique.
Le cinéma a lui aussi exploité sa puissance narrative. La piste de ski est un motif visuel puissant, largement exploité notamment par James Bond qui, film après film, dévale les flancs de montagne à vive allure, à ski, moto-neige ou avion, finissant parfois en parachute.[3]
dans Le monde ne suffit pas (1999), tourné à Chamonix.
La tempête de neige est également un cliché cinématographique très utile à la claustration des personnages, qu’il s’agisse de déclencher la terreur (comme dans Shining, 1980), ou au contraire d’y trouver un prétexte scénaristique à l’élaboration d’une comédie frisant l’absurde (Groundhog day, 1993). Par son caractère inattendu (la neige est toujours un événement au sens propre, une apparition), elle a également permis de rehausser d’innombrables scènes de romance. Les flocons virevoltant autour des visages des amoureux est un poncif incessamment rejoué, tant dans les « téléfilms de Noël » que dans le cinéma d’auteur.
La disparition de la neige menace enfin notre culture des loisirs, qui a pris son essor au XIXe siècle, autour des jeux et des sports de luge, de raquettes, de patins à glace, de ski et de bobsleigh. Chaque hiver, les médias s’emparent du sujet, constatant la dégradation des conditions neigeuses dans de nombreuses stations de ski européennes, dont certaines demeurent skiables grâce au recours à la neige artificielle. Des études annoncent d’ailleurs la fermeture de la quasi-totalité des stations de ski européennes d’ici la fin du siècle, laissant présager une crise de l’industrie du tourisme et des loisirs qui bouleverse déjà les régions montagneuses et leurs habitants.
A l’autre bout du globe, en lisière du désert d’Arabie, dans le Mall of Emirates de Dubaï, c’est aussi grâce à la neige artificielle que des personnes peuvent pratiquer toute l’année le ski et le snowboard sur une piste Indoor. Ici, la neige est déjà une attraction exotique, et une curiosité en rupture avec le climat de la région. Serait-ce là le destin annoncé de la neige sur terre ?
Où sont les bonhommes de neige ?
Avec la raréfaction de la neige dans une partie de l’Europe, fabriquer des bonhommes de neige est une pratique en voie de disparition. Sur la plateforme Histoires de nature du Museum nationale d’histoire naturelle de Paris et de son homologue berlinois que nous avons étudiée, dédiée à la collecte de témoignages sur la manière dont l’anthropocène transforme nos environnements, les récits de disparition des bonhommes de neige sont récurrents et souvent poignants.
Il faut dire qu’autour de ce rituel hivernal – tout comme celui de la « bataille de boules de neige » – se nouent des éléments d’ordre temporels et mémoriels (répétitivité annuelle, attente et impatience, symbole de l’hiver et de l’enfance), mais aussi une forte codification (des règles précises qui signalent sa bonne réalisation, comme la carotte en lieu et place du nez). A l’image du « Père Noël supplicié » dont parle l’anthropologue Claude Lévi-Strauss[4], il met en jeu le rite et permet à ce titre de produire de l’appartenance, au sein de la famille et entre amis ; il offre aussi, parce que la neige est rare, surprenante et parfois inquiétante, un moment de joie, d’émerveillement et de célébration du mystère de la vie en plein cœur de l’hiver, pour les enfants comme pour les adultes. Cette première photo du bonhomme montre ainsi le plaisir des adultes à fabriquer cet être de neige drôlement anthropomorphisé, qu’on regarde souvent fondre avec tristesse. La perte du bonhomme de neige, en tant que rituel hivernal, vient en ce sens questionner les processus de transmissions intergénérationnels.
Malgré la disparition des bonhommes de neige, ce dernier continue paradoxalement à occuper une place fondamentale dans les productions des industries culturelles et créatives à destination des enfants, ainsi que dans la littérature jeunesse.

Les exemples sont fort nombreux, et l’un d’entre eux possède désormais une réputation mondiale. Il s’agit évidemment d’Olaf, le gentil bonhomme de neige du film à succès La Reine des neiges, qui s’est imposé en quelques années comme l’un des personnages les plus populaires de l’univers Disney, décliné et reproduit des millions de fois sur des trousses, t-shirts, peluches ou porte-clés.
En quoi la disparition de la neige affecte-t-elle nos émotions ?
Il y a une vingtaine d’années, le philosophe Glenn Albrecht inventait le concept de « solastalgie »[5] pour désigner la détresse et la nostalgie causées par les bouleversements environnementaux. Le terme est aujourd’hui abondamment repris dans les médias et par la recherche en sciences humaines et sociales. La solastalgie est fille de la nostalgie, qui désigne étymologiquement le mal du pays (nostos signifie « retourner chez soi » en grec, et algia « la douleur ») liée notamment à l’exil, ou à l’impossibilité de rentrer chez soi. A la différence près qu’avec la solastalgie, il n’y a pas d’exil : les paysages ou notre habitat disparaissent d’eux-mêmes sous nos yeux, souvent de façon définitive et irrémédiable. Cette disparition conduit à ce que les chercheurs nomment l’amnésie environnementale générationnelle[6] : au fil des dégradations de l’environnement, chaque génération considère l’état dans lequel elle grandit comme le niveau non dégradé, autrement dit de référence.
La disparition de la neige conduira-t-elle un jour à ce que cette matière unique devienne le fantôme de l’histoire climatique de la terre ? Les boules à neige des boutiques de souvenirs que l’on secoue pour faire tomber les flocons au-dessus d’un Rio miniature ou des pyramides d’Egypte, n’ont-elles d’ailleurs pas déjà commencé l’opération de déréalisation de ce phénomène météorologique, paysager et culturel, devenu pure fantasmagorie marchande ?

[1]David Berliner, Perdre sa culture, Bruxelles, Zones sensibles, 2018
[2]Alain Corbin, L’homme dans le paysage, Paris, Textuel, 2001 et Alain Corbin La Pluie, le soleil et le vent. Une histoire de la sensibilité au temps qu’il fait, Paris, Aubier, 2013
[3] Voir https://www.snowtrex.fr/magazine/stations-de-ski/skier-avec-james-bond/
[4] Claude Lévi-Strauss, « Le père-Noël supplicié », Les Temps Modernes, no 77, 1952, p. 1572-1590. Paris, Gallimard.
[5] Glenn Albrecht et al, “Solastalgia: the distress caused by environmental change”, Australas Psychiatry, 2007, n°15
[6] P. H. Kahn, “Children’s affiliations with nature: Structure, development, and the problem of environmental generational amnesia.”, n P. H. Kahn, Jr. & S. R. Kellert (Eds.), Children and nature: Psychological, sociocultural, and evolutionary investigations (pp. 93–116). MIT Press.